entrevue
ENTREVUE AVEC BLAISE GALLAND
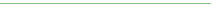
 Bio : Blaise Galland est né le 19 mai 1954 à Montevideo, de nationalité suisse (Genève). Il est diplômé d'études supérieures en science politique et docteur en sociologie et anthropologie. Il parle couramment le français, l'espagnol et l'anglais, et maîtrise l'allemand et le portugais.
Bio : Blaise Galland est né le 19 mai 1954 à Montevideo, de nationalité suisse (Genève). Il est diplômé d'études supérieures en science politique et docteur en sociologie et anthropologie. Il parle couramment le français, l'espagnol et l'anglais, et maîtrise l'allemand et le portugais.
A enseigné à l'Université de Genève et à l'EPFL et est actuellement chargé de cours à la HES de Lullier.
A imaginé, coordonné, dirigé et exécuté de nombreuses recherches scientifiques sur des thèmes tels que la société de l'information et l'Internet, les nouvelles dimensions de l'espace, l'environnement urbain, le logement social, des histoires de vie des ingénieurs et des architectes, les identités urbaines et spatiales, les politiques de santé publique, etc.
A écrit 9 livres et 21 rapports de recherche, et rédigé 12 chapitres dans d'autres livres et plus de 30 articles dans divers journaux et revues. A fait plus de 42 conférences et communications en Suisse et à l'étranger, et ses travaux ont fait l'objet de plus de 32 articles de journaux, émissions de radio et plateaux de télévision.
A effectué différents mandats d'études et expertises pour différentes instances privées et publiques suisses internationales telles que le FNRS, le Conseil d'Etat genevois, le Département Fédéral de Affaires Etrangères, la DGSE franç suisses, Qualintra SA, etc. Ancien délégué du CICR, il est aujourd'hui Conseiller communal à Bernex depuis 2003 et Commissaire à la protection des données pour le Canton de Genève.
Site Web : diwww.epfl.ch/~galland/
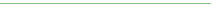
Cécile Petit - Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime beaucoup la définition de la ville que vous donnez dans votre article De l'urbanisation à la glocalisation (1995). Pourriez-vous nous la redonner ici ?
Blaise Galland - J'avais à l'époque donné une définition minimaliste de la ville, basée sur la théorie des réseaux. Selon celle-ci, la ville pouvait se définir comme étant « un nœud d'échanges de biens et d'informations ». Les biens s'échangent au marché, et les informations sur l'agora. La concentration humaine sur le territoire autour de ces deux lieux permet de minimiser le temps de l'échange de ces biens et de ces informations, tout en permettant une certaine transparence de la valeur des biens ainsi qu'une mise en communs des informations d'intérêt général déterminant la représentation « juste » du monde et de l'environnement à un moment donné de l'histoire.
C.P. - Si les villes se forment autour du marché et de l'Agora, et que ces deux pôles essentiels se déplacent vers le Cyberespace, est-ce à dire que c'est tout l'environnement urbain, tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est appelé à disparaître ?
B.G. - La ville en tant que telle n'est pas appelée à disparaître, puisqu'elle est déjà construite, qu'elle continue à se construire par sa propre inertie, et que les gens y habitent et veulent y habiter. Mais si les deux fonctions essentielles de la ville, telles qu'elles nous sont données par cette définition, basculent dans le cyberespace, c'est tout le sens de la ville qui est peut-être appelé à se réinventer, se restructurer et à se reformuler autour
d'autre(s) chose(s).
C.P. - J'ai envie de vous retourner textuellement une question que vous formulez dans votre article La ville virtuelle qui date de 1993 : est-ce que, plus de dix ans plus tard, « le concept urbain (a) basculé vers une réalité qualitative différente » ? Est-ce que « la finalité du travail des architectes, des urbanistes et des ingénieurs civil » se trouve bouleversée ? En d'autres termes, qu'en est-il de la ville aujourd'hui ?
B.G. - Si je me base sur la tradition leibnizienne de l'espace (comme étant « quelque chose d'uniforme absolument; et sans les choses y placées, un point de l'espace ne diffère absolument en rien d'un autre point de l'espace »), la ville n'a pas changé fondamentalement : d'un point de vue quantitatif, la grande majorité des villes n'ont cessé de croître en population et l'emprise au sol de ce mode d'être ensemble ne s'est pas subitement arrêté avec l'arrivée des nouvelles technologies. Cependant, l'espace étant une « intuition pure », le vécu intime d'un nombre croissant d'individus se transforme à travers l'usage des nouvelles technologies. D'un point de vue phénoménologique, je dirais aujourd'hui que le rapport à la ville a tendance à devenir plus distant, plus aérien, plus dispersé parce qu'une partie importante des préoccupations quotidiennes se trouve dans l'espace virtuel des réseaux. Et le développement du « Natel1 », comme on dit chez moi, a accentué ce mouvement de distanciation existentielle.
Le terme « bouleversée » était donc un peu exagéré, mais depuis les développements de l'automobile et des moyens de communication, on a assisté à deux processus successifs qui ont bien changé l'aspect et les usages des villes et qui créent pour les ingénieurs et les architectes d'autres objets urbains, impensables à une époque antérieure. La périurbanisation a poussé les classes aisées à sortir du centre-ville pour s'établir à la périphérie (et revenir en ville 20 ans plus tard, pour certains). Mais aujourd'hui, la mise en réseau des centres urbains, le processus de métropolisation, engendrent un certain nombre d'opportunités qui auraient été insensées à l'époque de la ville classique. Par exemple construire des centres commerciaux, avec cinéma, banque, restaurant, etc., en dehors des centres urbains, à mi-chemin entre deux centres urbains, eût été absurde dans une logique urbaine classique.
C.P. - Dans votre article De l'urbanisation à la glocalisation (1995), vous allez jusqu'à émettre l'idée d'une disparition progressive de la Poste, des universités, des bibliothèques, des musées, des opéras et des cinémas. C'est une idée qui a longtemps effrayé les gens, il y a quelques années de cela. Mais ne croyez-vous pas que nous assistons à ce jour à une adaptation réussie de ces espaces publics aux enjeux des nouvelles technologies ?
B.G. - C'est peut-être encore un peu trop pour se prononcer là-dessus, le web que nous connaissons n'a que douze ans d'usage social... Mais oui, tout à fait. On sait qu'un nouveau moyen de communication ne remplace jamais définitivement l'ancien. L'ancien survit en se réadaptant aux nouvelles donnes. Les musées mettent on-line toute une série de documents d'archives (j'ai un faible pour la conception et la réalisation du site de la Bibliothèque nationale de France) mais ce n'est pas pour cela que les musées disparaissent et que leur fréquentation baisse, c'est peut-être bien le contraire qui se passe, un peu comme avec les téléchargements « illégaux » de musique qui finissent par inciter les internautes à acheter de la musique, car, sans cette pratique de téléchargement, ils n'auraient pas eu connaissance de tel ou tel auteur. Mais qui dit adaptation dit aussi transformation. De la même manière que le fax est appelé à disparaître, des institutions toutes entières sont appelées à se repenser autrement, comme la poste, les universités, la bourse, les banques, etc.
C.P. - Vous pointez également très justement les limites des nouvelles technologies, à savoir le corps humain. Car, comme vous l'expliquez, même si le Cyberespace abolit les notions de temps et d'espace, l'être humain n'est, et ne sera jamais binaire. C'est, d'après vous, la raison majeure qui fait que l'on assiste d'avantage à un développement exponentiel des réseaux locaux plus que mondiaux, à une glocalisation plus qu'à une globalisation. Avant toute chose pouvez-vous définir ce terme de glocalisation pour nos lecteurs. Ensuite, êtes-vous d'accord avec l'idée que, de par l'avènement des nouvelles technologies et l'explosion du Cyberespace, le monde rapetisse au fur et à mesure où les réseaux locaux grossissent ? Enfin, quelle est la place de l'homme-physique et de l'homme-social dans cet espace virtuel ?
B.G. - J'avais défini la « glocalisation » comme étant le processus double par lequel la ville se décharge de sa fonction de production, d'échange et de traitement de l'information en la déplaçant dans le cyberespace, tout en développant, conséquemment, de nouvelles formes d'organisations socio-spatiales au niveau local. C'est ce qui se passe, ou peut se passer, au niveau local alors que les nouvelles technologies de l'informations sont globales. À un nouveau mode d'échange permis par le cyberespace, va correspondre une réorganisation de l'espace vécu, qu'il soit domestique ou collectif.
Je ne partage pas volontiers cette idée du « village global » de McLuhan, parce qu'elle est basée sur une analyse de la télévision dans les années soixante et parce qu'elle ne tient pas compte de l'interactivité permise par les réseaux informatiques. Et puis la circonférence de la planète ne va pas diminuer pour autant, et en tant qu'espace vécu, le « monde » me semble plutôt s'agrandir que rapetisser, par l'ouverture croissante des possibilités d'information et d'émission d'information par les particuliers, par la mise en commun, en un seul cyberespace, de la totalité des réseaux sociaux qui s'y constituent. Le monde m'apparaît ainsi « plus grand » parce que j'ai accès à des réseaux sociaux qui me seraient inaccessibles sans l'Internet. Mais au sacrifice du corps humain, car toute la force de l'Internet tient à ce qu'il annihile la contrainte de l'espace, et sans espace le corps humain ne peut pas vivre.
Dans cette configuration, la place de l'homme physique et biologique est bien plus complexe qu'aux débuts du 20ème siècle qui connaissaient encore une certaine corrélation entre l'espace réel d'un individu et son espace vécu. Avec l'espace vécu de l'Internet des voisins de paliers peuvent vivre à des années lumières les uns des autres. La place de l'homme à proprement parler ne change pas fondamentalement, parce qu'il gardera pour longtemps encore les pieds sur terre, on ne peut pas numériser le bios, et tous ses besoins animaux resteront pour très longtemps encore intrinsèquement liés à son environnement immédiat et local, à ce que sa ville pourra lui offrir dans la satisfaction de ces besoins. Mais il est vrai aussi que cette place se complexifie par l'indépendance croissante qu'il acquiert dans les réseaux et que son identité territoriale en devient de plus en plus difficile parce que parcellaire. D'où cette notion de glocalisation qui, s'appliquant à l'individu, le fait apparaître comme ayant les pieds sur terre et la tête dans le cyberespace.
C.P. - Pour terminer, j'aimerais revenir sur la métaphore de la ville souvent utilisée pour représenter le Cyberespace, métaphore que vous utilisez également dans La ville virtuelle. En quoi l'espace virtuel, immatériel par définition, sans limite ni territoire, peut-il être comparé à une structure urbaine ? Quels en sont les points communs autant que les limites ?
B.G. - Au-delà de la « tuyauterie » qui véhicules les informations du cyberespace, ce qui le constitue en termes d'usages, ce sont les différents sites Internet qui s'y installent. Chacun de ces sites sont comme des immeubles, avec son propriétaire, ses habitants et ses usagers, et juxtaposés les uns aux autres tous ces « lieux » finissent par ressembler à une ville. Il s'agit certes d'une métaphore, mais c'est la première qui est venue en tête des pionniers de « l'internautique », si je peux utiliser ce terme non consacré par l'académie française. Comme toute métaphore, cette image parvient vite à ses limites lorsqu'on approfondit la comparaison entre une ville et le cyberespace. A priori la ville virtuelle peut grandir à l'infini puisqu'elle n'es pas liée à un territoire particulier et donc ne connaît pas les limites géographiques du temps, de la distance et de l'espace qui sont déterminantes pour nos villes. Mais la concentration humaine et la diversité sociale qui sont les caractéristiques de l'urbain sont bien présentes dans le cyberespace qui dès lors ressemble à une ville telle que nous les connaissons. La métaphore se dissout dès lors que l'on prend en compte la dimension spatiale, ce qui n'est pas la moindre lorsqu'on a à faire à une ville. En Occident, les immeubles d'une ville se hiérarchisent grosso modo en fonction de leur distance par rapport au centre. Or, dans la ville virtuelle des réseaux où la distance est justement abolie, il n'y a plus ni centre, ni limite, ni périphérie, et la seule hiérarchie qui entre alors en ligne de compte, c'est le taux de fréquentation des différents sites. Ainsi un site fréquenté « ressemble » à un édifice, parce qu'on y « entre », parce que beaucoup de gens sont là en même temps que nous pour y faire la même chose. Et tous ces « immeubles » ainsi juxtaposés finissent par ressembler à une ville, à la ville la plus peuplée et la plus diversifiée du monde que l'on puisse imaginer. A la différence d'une vraie ville les rues n'existent plus parce qu'en abolissant la contrainte de l'espace, nous avons quitté la troisième dimension.
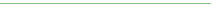
Notes
1 : Téléphone mobile 
Entrevue réalisée par Cécile Petit

 haut de page haut de page
 retour retour
|
